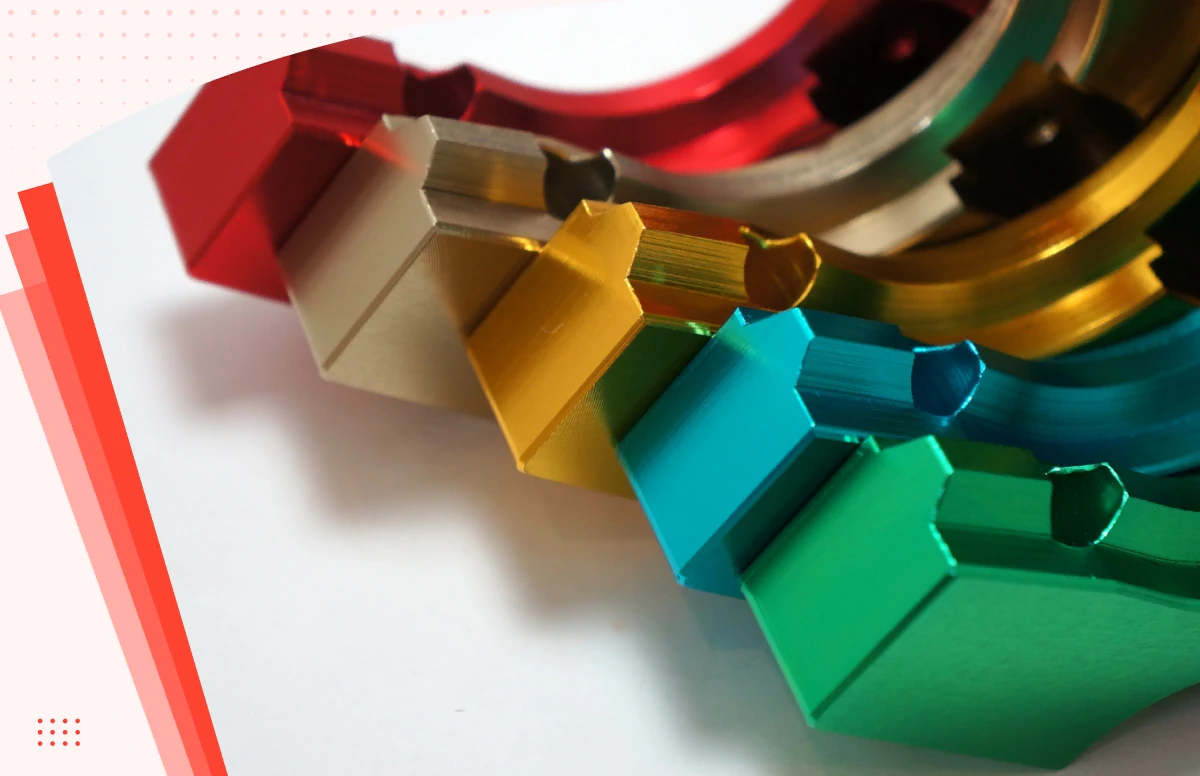Dans le processus complet de fabrication des pièces moulées, le « traitement chimique » sert de lien essentiel entre les processus en amont et en aval. Contrairement au moulage qui détermine la forme des pièces moulées ou à l'usinage qui contrôle la précision dimensionnelle, le traitement chimique modifie l'état de surface ou la composition interne des pièces moulées par des réactions chimiques, résolvant ainsi des problèmes pratiques tels que « les surfaces sujettes à la rouille », « les surfaces difficiles à revêtir » et « la mauvaise résistance à l'usure ». De nombreux praticiens considèrent le traitement chimique de manière restrictive comme un simple « dérouillage », mais ne comprennent pas clairement la valeur spécifique des différentes techniques : « Quelle est la différence entre le lavage à l'acide et la phosphatation ? Quel est l'objectif des revêtements de conversion chimique ? Comment le traitement par infiltration métallique améliore-t-il les propriétés des pièces moulées ? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur six processus de traitement chimique essentiels pour les pièces moulées, en décomposant la fonction, le principe et les scénarios d'application de chaque technique dans un langage simple afin de vous aider à comprendre pourquoi différents traitements chimiques sont sélectionnés pour différents besoins.
Décapage : processus de transformation qui élimine l'oxydation superficielle et les impuretés des pièces moulées.
Le lavage à l'acide est le processus de prétraitement chimique le plus élémentaire des pièces moulées. Son rôle principal est d'éliminer les oxydes, la corrosion, l'huile, la saleté et les impuretés résiduelles à la surface des pièces moulées, afin de « lever les obstacles » pour la peinture, la galvanoplastie ou l'assemblage ultérieurs, ce qui équivaut à un « nettoyage en profondeur » des pièces moulées.

principe technique
La pièce moulée est immergée dans une solution acide (les acides couramment utilisés sont l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide nitrique, qui doivent être ajustés en fonction du matériau de la pièce moulée), et le nettoyage est obtenu grâce à la réaction chimique entre l'acide et les polluants de surface :
Les oxydes (tels que Fe₃O₄ sur les surfaces en fonte et Al₂O₃ sur les surfaces en alliage d'aluminium) réagissent avec l'acide pour former des sels solubles, qui sont emportés par la solution.
Les produits de corrosion (tels que Fe₂O₃) seront dissous par l'acide, exposant la surface d'origine du substrat de moulage ;
L'huile sera séparée de la surface et séparée de la solution sous l'émulsification de l'acide.
Après traitement, la pièce moulée doit être lavée à l'eau claire afin d'éliminer les résidus d'acide, puis séchée afin d'éviter toute corrosion secondaire.
rôle clé
Éliminez complètement les couches d'oxyde et résolvez les problèmes d'écaillage de la peinture : après le moulage, des couches d'oxyde denses se forment sur les surfaces moulées. La peinture directe entraîne une mauvaise adhérence entre les revêtements et les substrats, ce qui provoque l'écaillage de la peinture et la formation de cloques à la surface. Une fois les couches d'oxyde éliminées par lavage à l'acide, les surfaces moulées atteignent une rugosité optimale (Ra6,3-12,5 μm) et l'adhérence du revêtement est améliorée de plus de 50 %. Par exemple, les composants en fonte des machines agricoles présentent des niveaux d'adhérence améliorés après lavage à l'acide : le niveau d'adhérence de la peinture passe de « Grade 3 » (écaillage partiel des bords) à « Grade 1 » (aucun écaillage) lors du recouvrement.
Éliminer la rouille et restaurer l'état de surface des pièces moulées : l'exposition à l'humidité pendant le stockage ou le transport peut entraîner la formation de rouille (par exemple, rouille rouge sur les pièces moulées en acier au carbone, taches blanches sur les alliages d'aluminium). Le lavage à l'acide dissout efficacement la rouille sans endommager le matériau de base. Par exemple, les pièces moulées de vannes en acier inoxydable peuvent retrouver leur éclat métallique d'origine après une légère exposition à la rouille grâce à un traitement à l'acide nitrique, ce qui élimine le besoin d'un polissage supplémentaire.
Élimination des contaminants de fonderie pour améliorer la précision d'usinage : des particules de sable résiduelles et des scories issues des processus de moulage peuvent rester sur les surfaces moulées. Si elles ne sont pas traitées, ces contaminants peuvent accélérer l'usure des outils pendant l'usinage et compromettre la précision dimensionnelle. Le lavage à l'acide élimine efficacement ces impuretés par dissolution chimique et rinçage mécanique, réduisant ainsi considérablement les risques liés à l'usinage. Par exemple, le lavage à l'acide peut prolonger la durée de vie des outils de fraisage de 30 % dans les applications de moulage de moyeux en alliage d'aluminium.
scène applicable
Pièces moulées présentant une couche d'oxyde et de la corrosion à la surface (telles que l'acier au carbone, la fonte, les pièces moulées en acier inoxydable) ;
Pièces moulées devant être peintes, galvanisées, pulvérisées ou subir d'autres traitements de surface ;
Pièces moulées légèrement corrodées après stockage ou transport et devant retrouver leur état de surface d'origine.
Phosphatation : application d'un revêtement protecteur sur les pièces moulées afin de créer une couche de base résistante à la rouille pour la peinture.
La phosphatation est un processus courant après le lavage à l'acide. Son rôle principal est de former un film de conversion phosphate dense à la surface de la pièce moulée. Ce film peut non seulement jouer un rôle antirouille à court terme, mais aussi améliorer l'adhérence du revêtement ultérieur, ce qui équivaut à revêtir la pièce moulée d'un « vêtement protecteur ultrafin ».

principe technique
Après le lavage à l'acide, les pièces moulées sont trempées dans une solution de phosphate (les composants courants comprennent le phosphate de zinc, le phosphate de manganèse et le phosphate de fer), et une couche de film cristallin de phosphate insoluble dans l'eau (dont l'épaisseur est généralement comprise entre 5 et 50 μm) se forme à la surface des pièces moulées par réaction chimique :
Les ions phosphate présents dans la solution réagissent avec les ions métalliques (tels que Fe²⁺, Al³⁺) du substrat de moulage pour former un précipité de phosphate ;
Le précipité s'accumule progressivement à la surface, formant une couche cristalline uniforme et dense, qui adhère étroitement au substrat.
Après la phosphatation, la couche de film doit être « scellée » (par exemple en la trempant dans un inhibiteur de rouille) afin d'améliorer encore la résistance à la rouille de la couche de film.
Rôle central
Prévention de la rouille à court terme et prolongation de la durée de stockage des pièces moulées : le film de phosphate isole l'air, l'humidité et le substrat moulé, offrant ainsi une protection contre la rouille. Par exemple, les pièces moulées en acier au carbone peuvent voir leur période de résistance à la rouille passer de « 1 mois » à « 6 mois » lorsqu'elles sont stockées à l'intérieur après phosphatation, éliminant ainsi le besoin d'huile antirouille supplémentaire et réduisant les coûts de stockage.
Améliorez l'adhérence du revêtement et empêchez le décollement : la surface du film de phosphate contient de fins pores. Lors de la peinture ultérieure, le revêtement pénètre dans ces pores, formant un verrouillage mécanique qui améliore considérablement l'adhérence. Par exemple, les composants en fonte du châssis automobile atteignent une adhérence de classe 0 (zéro décollement) après phosphatation et revêtement électrophorétique, tandis que la résistance au brouillard salin du revêtement passe de 200 heures à 500 heures.
Améliore la lubrification et facilite le traitement et l'assemblage ultérieurs : le film de phosphate assure la lubrification, réduisant ainsi les frottements lors de l'estampage, de l'emboutissage ou de l'assemblage des pièces moulées. Par exemple, le coefficient de frottement des tôles estampées (anciennement pièces moulées) diminue de 0,3 à 0,15 après phosphatation, ce qui empêche la déformation ou l'usure des moules causées par des frottements excessifs.
scène applicable
Pièces moulées nécessitant une peinture et une électrophorèse ultérieures (telles que les pièces de carrosserie automobile et les carters de machines agricoles) ;
Pièces moulées en acier au carbone et en fonte qui doivent être stockées ou transportées pour une prévention de la rouille à court terme ;
Ébauche de pièce moulée à traiter par emboutissage, étirage et autres procédés plastiques.
Revêtement par conversion chimique : films protecteurs sur mesure pour les pièces moulées en métaux non ferreux
Le principe du traitement par film de conversion chimique est similaire à celui de la phosphatation, mais il se concentre davantage sur les pièces moulées en métaux non ferreux tels que les alliages d'aluminium, de magnésium et de zinc. Son rôle principal est de former un film de conversion chimique spécial à la surface afin de résoudre le problème de « l'oxydation facile et de la protection difficile » des métaux non ferreux.

principe technique
Différentes solutions chimiques sont sélectionnées en fonction du matériau de moulage, et des films de conversion ciblés sont générés par des réactions chimiques :
Moulage en alliage d'aluminium : chromate couramment utilisé, agent de passivation sans chrome (protection de l'environnement), formant un film de chromate ou un film de passivation sans chrome (épaisseur du film 0,5-2 μm), isolant l'air et l'humidité ;
Moulage en alliage de magnésium : utilisation courante d'acide fluorhydrique ou de solution fluorurée, formation d'un film de conversion au fluorure de magnésium pour améliorer la résistance à la corrosion ;
Moulage en alliage de zinc : utilisation courante d'une solution de chromate, formation d'un film de chromate de zinc, prévention du blanchiment et de la rouille de la surface.
Après traitement, le film de conversion ne nécessite pas de cuisson à haute température et peut être séché à température ambiante, ce qui convient aux pièces moulées en métal non ferreux à parois minces sensibles à la déformation.
rôle clé
Relever le défi de la « tendance à l'oxydation » des métaux non ferreux : les pièces moulées en alliages d'aluminium et de magnésium ont tendance à former des films d'oxyde lâches à l'air libre, qui non seulement ne fournissent pas une protection efficace contre la rouille, mais compromettent également les processus de revêtement ultérieurs. Les revêtements de conversion chimique créent des couches protectrices denses. Par exemple, le traitement de passivation sans chrome pour les pièces moulées en alliage d'aluminium des cadres de smartphones réduit les taux d'oxydation de surface de 90 %, ce qui permet de conserver une finition peinte en blanc sans décoloration, même après trois mois de stockage.
Résistance à la corrosion améliorée et adaptation aux environnements difficiles : le film de conversion résiste à l'érosion des agents corrosifs tels que l'acide, les alcalis et le brouillard salin. Par exemple, la résistance à la corrosion des pièces moulées en alliage de magnésium utilisées dans la structure des drones après traitement par un film de conversion au fluorure de magnésium passe de « 50 heures » à « 200 heures », ce qui permet une adaptation aux environnements extérieurs humides et exposés au brouillard salin.
Compatible avec divers traitements de surface et adaptable à divers besoins : la surface lisse du film de conversion permet une application directe en tant que couche protectrice finale (idéale pour les pièces moulées exposées) ou en tant que couche de base pour le revêtement ou la galvanoplastie. Par exemple, les pièces moulées en alliage de zinc pour les équipements sanitaires peuvent subir un traitement par film de conversion au chromate suivi d'un chromage, ce qui améliore l'adhérence et empêche les réactions chimiques entre l'alliage de zinc et la couche de chrome.
scène applicable
Pièces moulées en métaux non ferreux telles que les alliages d'aluminium, de magnésium, de zinc (par exemple, accessoires pour téléphones portables, pièces pour drones, produits pour salles de bains) ;
Utilisation à l'air libre, pièces moulées en métaux non ferreux avec des exigences en matière d'apparence et de résistance à la corrosion ;
Les pièces moulées en métaux non ferreux nécessitent un traitement préalable par galvanoplastie et pulvérisation.
Placage sans courant : création d'un revêtement métallique sur des pièces moulées sans électrodes
Le placage chimique (également appelé placage sans courant) est un procédé de revêtement qui ne nécessite aucune alimentation électrique externe. Sa fonction principale consiste à déposer uniformément un revêtement métallique (tel que du nickel, du cuivre ou de l'or) à la surface de la pièce moulée, ce qui améliore non seulement l'aspect et la texture, mais aussi la résistance à l'usure et à la corrosion. Ce procédé est particulièrement adapté aux formes complexes et aux cavités profondes des pièces moulées.

Principe du processus
La pièce moulée est immergée dans une solution de placage chimique contenant des ions métalliques (telle qu'une solution de nickelage chimique contenant du Ni²⁺ et un agent réducteur, l'hypophosphite de sodium). Grâce à une réaction chimique, les ions métalliques sont réduits en éléments métalliques à la surface de la pièce moulée et se déposent progressivement pour former un revêtement :
L'agent réducteur présent dans la solution de placage (tel que l'hypophosphite de sodium) fournit des électrons pour réduire le Ni²⁺ en atomes de Ni.
Les atomes d'azote s'accumulent en continu à la surface de la pièce moulée pour former un revêtement uniforme et continu (généralement d'une épaisseur de 5 à 50 μm), et l'épaisseur du revêtement peut être maintenue de manière constante quelle que soit la complexité de la forme de la pièce moulée.
rôle clé
Les pièces moulées complexes peuvent désormais bénéficier d'un « revêtement uniforme » qui élimine les « zones d'ombre de la galvanoplastie » : la galvanoplastie traditionnelle repose sur le courant électrique, qui crée souvent des « zones mortes » dans les cavités profondes et les angles des pièces moulées, ce qui se traduit par des revêtements fins ou inexistants. Le placage chimique, grâce au dépôt par réaction chimique, permet d'obtenir un « revêtement uniforme complet ». Par exemple, dans les pièces moulées de vannes en acier inoxydable avec des trous profonds (5 mm de diamètre, 50 mm de profondeur), l'écart d'épaisseur du revêtement de nickel entre les surfaces intérieure et extérieure après placage chimique est ≤ 1 μm, tandis que la galvanoplastie peut présenter des écarts de 5 à 10 μm.
Amélioration de la résistance à l'usure et prolongation de la durée de vie des pièces moulées : les revêtements métalliques (tels que les revêtements en alliage nickel-phosphore) sont nettement plus durs que le matériau de base. Par exemple, la dureté de surface des rails de machines-outils en fonte passe de HB200 à HV800 après un nickelage chimique, ce qui augmente la résistance à l'usure de 3 à 5 fois et prolonge la durée de vie de 3 à 10 ans.
Amélioration de la conductivité et de l'esthétique pour répondre à des exigences spécifiques : le placage chimique au cuivre augmente la conductivité électrique des pièces moulées (idéal pour les composants électroniques), tandis que le placage à l'or améliore l'attrait visuel des pièces moulées décoratives. Par exemple, les connecteurs électroniques en alliage d'aluminium moulés bénéficient d'une amélioration de 20 % de leur conductivité grâce au placage au cuivre, ce qui garantit une transmission stable du signal. Les bijoux en alliage de zinc moulés obtiennent une finition brillante grâce au placage à l'or, qui offre une meilleure résistance à l'usure et une meilleure rétention de la couleur.
scène applicable
Pièces moulées présentant des formes complexes, des cavités profondes/des angles tournants, difficiles à recouvrir uniformément par galvanoplastie traditionnelle ;
Pièces moulées soumises à des exigences élevées en matière de résistance à l'usure et à la corrosion (telles que les rails de guidage des machines-outils, les surfaces d'étanchéité des vannes) ;
Accessoires électriques et pièces moulées décoratives nécessitant une amélioration de la conductivité ou de la texture esthétique.
Diffusion chimique des métaux : obtenir l'uniformité des pièces moulées grâce à l'amélioration interne des matériaux
Le traitement par infiltration métallique est un « traitement chimique en profondeur ». Sa fonction principale consiste à infiltrer des éléments métalliques (tels que le chrome, l'aluminium et le zinc) dans la couche superficielle de la pièce moulée par diffusion chimique, afin de modifier la composition chimique et la microstructure de la couche superficielle et d'améliorer ainsi la résistance à l'usure et à la corrosion. De plus, les performances sont progressivement transférées de la couche superficielle vers l'intérieur, afin d'éviter le problème du « détachement facile de la couche superficielle ».

principe technique
La pièce moulée est placée dans un milieu contenant les éléments métalliques cibles (tels que la poudre de chrome pour l'infiltration de chrome, la poudre d'aluminium pour l'infiltration d'aluminium) et maintenue à une certaine température (généralement entre 500 et 1000 °C) pendant un certain temps. Grâce à une réaction chimique et à la diffusion, les éléments métalliques s'infiltrent dans la couche superficielle de la pièce moulée :
Les éléments métalliques présents dans le milieu réagissent d'abord avec d'autres composants pour former des ions actifs (tels que Cr³⁺) ;
À haute température, les ions actifs se diffusent dans la couche superficielle de la pièce moulée, formant un alliage avec le métal de base (par exemple, un alliage Cr-Fe après infiltration de chrome), créant ainsi une couche d'infiltration (généralement d'une épaisseur de 0,1 à 2 mm).
rôle clé
Résistance à la corrosion et aux températures élevées considérablement améliorée, adaptée aux environnements à haute température : les traitements d'infiltration d'aluminium et de chrome permettent aux pièces moulées de former un film d'oxyde stable dans des conditions de température élevée, résistant ainsi à l'oxydation et à la corrosion à haute température. Par exemple, les pièces moulées en acier au carbone pour chaudières présentent une réduction de 95 % du taux d'oxydation à 600 °C après infiltration d'aluminium, ce qui prolonge leur durée de vie de « 1 an » à « 5 ans » sans remplacement fréquent.
Amélioration de la résistance à l'usure pour les applications à forte friction : les pièces moulées chromées ou plaquées au bore (le bore étant un élément non métallique mais présentant des caractéristiques de traitement similaires) développent une couche d'alliage très dure à leur surface. Par exemple, un composant en fonte d'un marteau de concasseur atteint une dureté de surface de HV1200 après chromage, contre HB250, ce qui se traduit par une résistance à l'usure 4 à 6 fois supérieure. Cette amélioration permet d'augmenter la capacité de concassage totale de 10 000 tonnes à 50 000 tonnes.
Aucun revêtement supplémentaire n'est nécessaire pour empêcher le décollement de la surface : la liaison métallurgique entre la couche d'infiltration de zinc et le substrat élimine les risques de décollement de la surface. Les socs de charrue agricoles en sont un exemple : lorsqu'ils sont imprégnés de zinc, ils conservent leur intégrité structurelle même en cas de frottement prolongé contre le sol, alors que les revêtements galvanisés classiques s'usent généralement en moins de six mois.
scène applicable
Pièces moulées (telles que pièces de chaudières, accessoires d'équipements chimiques) fonctionnant dans des environnements à haute température et corrosifs pendant une longue période ;
Pièces moulées soumises à des frottements et à une usure importants (telles que têtes de marteaux de concasseurs, rouleaux, charrues) ;
Pièces moulées pour machines lourdes présentant une forte adhérence de surface et ne tolérant aucun détachement du revêtement.
Nettoyage chimique : processus de nettoyage de précision des pièces moulées visant à éliminer les résidus d'huile microscopiques et les impuretés.
Le nettoyage chimique diffère du lavage à l'acide. Il s'agit d'un processus de nettoyage de surface plus raffiné. Son rôle principal est d'éliminer les micro-traces d'huile, les empreintes digitales, la poussière et autres polluants légers à la surface des pièces moulées sans enlever la couche d'oxyde. Il convient aux pièces moulées qui ont été traitées ou qui présentent un bon état de surface.
principe technique
Utilisez des agents nettoyants chimiques faiblement alcalins ou neutres (tels que des tensioactifs ou des agents chélateurs) pour nettoyer les surfaces par émulsification, dissolution et dispersion.
Le tensioactif peut émulsionner et décomposer l'huile et la saleté, afin qu'elles soient séparées de la surface de la pièce moulée ;
Les agents chélateurs peuvent se lier aux ions métalliques de surface (tels que le Fe³⁺ légèrement corrodé) pour empêcher la formation de nouveaux polluants ;
Après le nettoyage, rincer à l'eau pure pour éviter tout résidu de produit nettoyant, puis sécher ou sécher à l'air.
rôle clé
Élimination des micro-contaminants huileux pour une précision d'assemblage : les pièces moulées usinées peuvent conserver des résidus de liquide de coupe, des empreintes digitales et d'autres contaminants à leur surface. Ces résidus peuvent compromettre l'ajustement de l'assemblage (par exemple, une contamination huileuse sur les surfaces d'étanchéité peut entraîner une mauvaise étanchéité). Après un nettoyage chimique, les résidus d'huile en surface peuvent être contrôlés à moins de 5 mg/m². Par exemple, dans les pièces moulées de blocs de vannes hydrauliques, le taux de fuite des surfaces d'étanchéité est passé de « 5 % » à « 0,1 % » après nettoyage, garantissant ainsi le bon fonctionnement des systèmes hydrauliques.
Nettoyage de surface de précision pour les applications à haute tolérance : les pièces moulées de haute précision (par exemple, les composants de dispositifs médicaux, les pièces électroniques) nécessitent des surfaces impeccables, exemptes de contaminants, car même des traces d'impuretés peuvent compromettre leur fonctionnalité. Le nettoyage chimique permet d'obtenir une pureté de l'ordre du micron. Prenons l'exemple des instruments chirurgicaux en acier inoxydable : après nettoyage, les surfaces ne présentent aucune impureté visible et les niveaux de résidus bactériens sont conformes aux normes médicales. Ce processus élimine le besoin d'une stérilisation supplémentaire à haute température (adaptée à certains matériaux).
Protéger les surfaces finies contre les dommages : pour les pièces moulées à finition de précision (par exemple, les composants décoratifs polis) présentant des surfaces lisses, les processus fortement corrosifs tels que le lavage à l'acide peuvent endommager la surface. Cependant, le nettoyage chimique à l'aide de solutions neutres ou faiblement alcalines préserve la rugosité et le brillant de la surface. Par exemple, les bijoux moulés en alliage d'aluminium poli conservent leur brillant d'origine après un nettoyage chimique, sans rayures ni traces de corrosion.
scène applicable
Pièces moulées de précision présentant des résidus de liquide de coupe et d'huile après usinage ;
Nettoyer les pièces moulées (telles que les blocs de vannes hydrauliques et les brides) au niveau des surfaces d'étanchéité et des surfaces de joint avant l'assemblage ;
Pièces moulées polies et galvanisées nécessitant un nettoyage minutieux et une protection contre les dommages.
Conclusion
Le traitement chimique des pièces moulées n'est pas un « choix unique », mais une « matrice de solutions » personnalisée en fonction du matériau des pièces moulées et des exigences ultérieures (antirouille, peinture, résistance à l'usure) :
Le lavage à l'acide est le « nettoyage de base » qui élimine les obstacles au traitement ultérieur ;
La phosphatation est la « couche de base protectrice », qui tient compte de la compatibilité entre la protection antirouille et le revêtement ;
Le film de conversion chimique est « exclusivement protecteur pour les métaux non ferreux » afin de résoudre le problème de l'oxydation ;
Le placage chimique est un « procédé de revêtement de pièces complexes » permettant d'obtenir une amélioration uniforme des performances ;
Le métallisation est une « optimisation approfondie des performances », améliorant le matériau de la surface vers l'intérieur ;
Le nettoyage chimique est un « nettoyage fin », adapté aux exigences de précision d'assemblage et d'apparence.
Il est essentiel de comprendre les fonctions principales de chaque traitement chimique afin de sélectionner le processus optimal pour différents moulages, de relever efficacement les défis pratiques tout en évitant les coûts inutiles liés à un « traitement excessif ». Si vous avez des questions sur les « options de traitement chimique pour des moulages de matériaux spécifiques » ou les « combinaisons de processus pour des scénarios particuliers », n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Nous continuerons à partager davantage de connaissances pratiques sur les traitements chimiques des moulages !